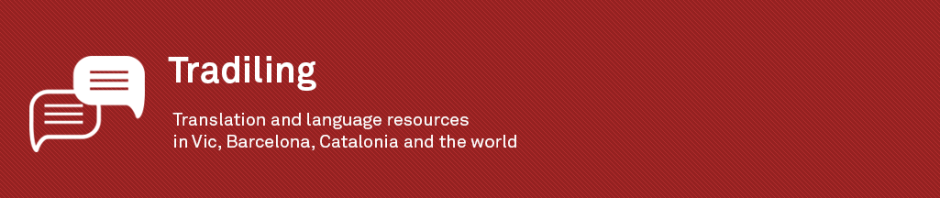Le 8 avril 2021, la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, appelée aussi loi Molac, a été adoptée par l’Assemblée nationale sur la suggestion du député d’origine bretonne Paul Molac avec l’opposition du ministère de l’Éducation. Cette proposition de loi octroie à la langue française et aux langues régionales la catégorie de trésor national et comprend des mesures concernant trois aspects : le patrimoine, l’enseignement et leur emploi dans les services publics. Quelques semaines plus tard, le 21 mai 2021, le Conseil constitutionnel l’a partiellement censurée. Ce que le Conseil a raboté, c’est l’enseignement par immersion et l’utilisation des signes diacritiques en langues régionales. Au contraire, il a autorisé, entre autres, l’enseignement généralisé de ces langues comme matière facultative et le recours à la traduction en langues régionales des documents institutionnels. Ce fait a rouvert le débat sur la politique linguistique en France ainsi que le besoin de rappeler la situation des langues locales françaises.
D’après l’information qu’il y a sur le site web du ministère de la Culture français, les langues régionales dans l’Hexagone sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, dialectes allemands d’Alsace et de Moselle (alsacien et francique mosellan), flamand occidental, francoprovençal, langues d’oïl (bourguignon-morvandiau, champenois, franc-comtois, gallo, lorrain, normand, picard, poitevin-saintongeais, wallon), occitan ou langue d’oc (gascon, languedocien, provençal, auvergnat, limousin, vivaro-alpin) et parlers liguriens. À ces langues s’ajoutent les langues locales des territoires d’Outre-mer, comme les créoles, le tahitien ou le wallisien et futunien.
Quant aux locuteurs parlant ces langues, selon le Rapport du Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique interne (2013), il y a six langues régionales qui sont encore utilisées couramment en France métropolitaine : l’alsacien-francique-mosellan, le basque, le breton, le catalan, le corse et l’occitan. Cependant, dans ce même document, on reconnaît que « des études plus ponctuelles permettent de considérer la baisse de la pratique de ces langues en France métropolitaine comme l’hypothèse la plus probable » (p. 12).
Arrivés à ce point, nous considérons donc que la loi Molac, même si elle a été retoquée en partie, constitue un pas important pour la préservation des langues minorisées dans l’État français, un état traditionnellement centralisé. Car, comme l’anthropologue Claude Lévi-Strauss a écrit : « Qui dit homme dit langage, et qui dit langage dit société ». Et pour terminer, nous vous invitons à vivre une expérience linguistique passionnante en écoutant une fable d’Ésope en 307 langues et patois. À cette fin, il suffit de cliquer sur cette carte interactive des langues régionales françaises, créée par des linguistes et chercheurs au Centre national de recherche scientifique (CNRS).